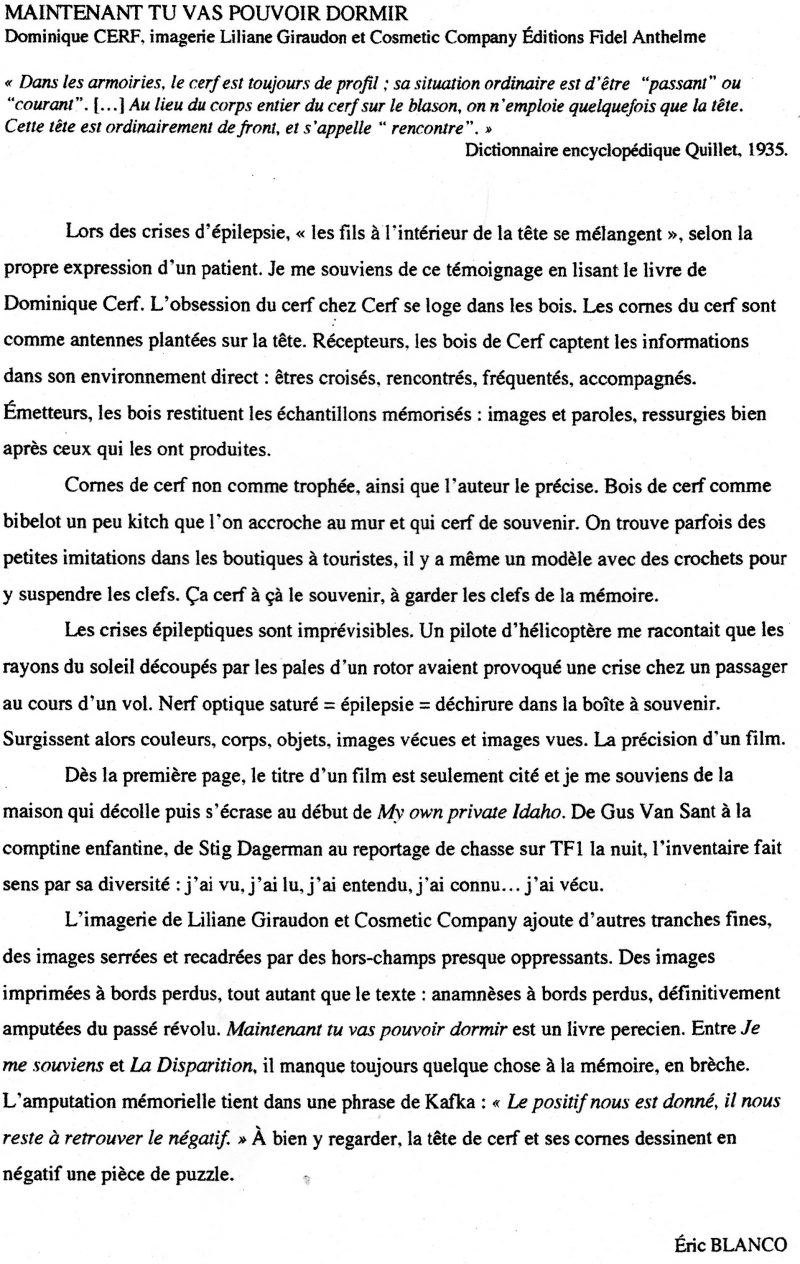Dominique Cerf, Charles Gouvernet, Table ronde, lycée du Rempart, 22 janvier 2013.
Les pièces de Dominique Cerf et de Charles Gouvernet ne parlent pas mais elles ont des choses à dire en sculpture et en peinture, elles ont des choses à nous dire et à se dire entre elles. L’exposition n’a d’ailleurs pas été initialement pensée comme un dialogue. Mais l’accrochage met les œuvres en regard et un dialogue muet nait de ce face à face, un échange silencieux dont les visiteurs – spectateurs peuvent, ou non, percevoir le murmure.
Les grandes toiles de Charles Gouvernet et les pièces de Dominique Cerf ne s’adressent pas vraiment la parole. Ce sont des travaux qui utilisent des mots de taiseux et de mal lunés. Il faut dire que tout en respirant le même air, ils ne parlent pas vraiment la même langue. Tous deux sont plein de mauvaise volonté. Ils n’ont pas envie de se donner, comme les artistes n’ont pas envie que l’on parle d’eux. Ils exigent que le visiteur appréhende leur travail à partir de cette ignorance-là. Mais il est joyeux de s’apercevoir que la mauvaise volonté de l’un redonne à l’autre son élan et que cela les fait rire comme des enfants.
Le travail de Dominique Cerf qui combine l’intime et le colossal vient, me semble-t- il, à la marge de quelque chose ; à la marge en tous cas des pratiques identifiables de la sculpture, de l’architecture, de la photo vernaculaire. Pour être appréhendées, ces pièces nous font effectuer de multiples déplacements de la pensée. Elles restent cependant insaisissables. Je pense au cerf qui s’échappe de la colonne de béton, mais aussi à ceux minuscules qui en parcourent l’étendue bleue. Je pense au buis qui pousse dans le sein rouge du béton. Les choses sont ouvertement déplacées mais la logique convoquée n’a rien à voir avec le surréalisme. C’est plus direct et plus brut. Les objets familiers comme des visages sont transformés en musée populaire et affectif. Collés dans des boites, ils figurent comme à la marge d’un album de famille. On traine alors à la marge du chantier et de l’album. Donc, ni la sculpture, ni la peinture, ni la photographie, la marge.
Cette marge est aussi le lieu du commentaire sur un autre texte. C’est un commentaire en forme de contestation, comme en signe de colère productrice et pensante. Le travail de Dominique Cerf me semble être en marge justement comme un travail qui commente et qui excède la sculpture, la photographie ou les installations. La marge comme un signe d’excès, mais aussi la marge qui ‘excède’ dans le sens de ce qui insupporte, qui abomine, qui exaspère. Parce que ces marges là, qui cassent les déterminismes et les liens de filiations, sont exaspérantes pour certains regards. Abominables peut-être. Je reçois ce travail à la marge parce qu’il commente le monde contemporain depuis cet excès de la marge et qu’il le fait avec une infinie délicatesse, avec élégance comme quand on met les pieds dans le plat sans le faire exprès et que cela provoque un léger pas de danse.
Faire face aux pièces de Dominique Cerf comme Charles Gouvernet en fait ici l’expérience, c’est être confronté à cet excès et à cette exaspération. Le murmure produit est riche parce qu’il monte d’une autre marge, toute aussi fragile, aussi inconfortable et solitaire.
Le peu que je connais des toiles de Charles Gouvernet me dit qu’il n’y a dans ce travail de peinture ni soumission au sens, ni à la forme, ni même au regard. Sur ces toiles, je vois d’abord de la présence. Je vois des traces de pinceaux, mais aussi des tracés effacés. Je vois des végétaux, des racines, des morceaux de corps, lignes, avions, vaisseaux, peluches, échelles, croix, mais je vois aussi des structures effacées. Ces traces sont blanchies sans repentir, avec force pour justement figurer l’effacement et lui donner la même importance qu’à la trace. Comme dans les arts sonores où l’enjeu est parfois de faire exister le silence, ici la peinture figure l’acte de l’apparition et de la disparition. Peindre pour montrer que le geste pictural a aussi la puissance d’effacer est sans doute un des enjeu de ce travail.
Ici aussi, la pensée du visiteur se déplace de fait. Elle glisse vers les marges de la représentation. Le travail de Charles Gouvernet invite à s’éloigner du plaisir mimétique. On glisse ainsi vers une expérience limite qui désigne la possibilité du déplaisir sans nous y faire basculer totalement. Et c’est ce vacillement qu’active la peinture de Charles Gouvernet, cette expérience répétée d’une limite intenable. Cette dernière n’est probablement pas sans lien avec certaines expériences mystiques mais il est clair qu’elle s’en méfie pourtant aussi.
L’accrochage de la galerie du Passage de l’art met à jour ce dialogue de marge à marge, ce murmure de l’exaspération et du vacillement. Sans s’adresser la parole, les pièces de Dominique Cerf et de Charles Gouvernet savent leur fragilité respective. Chez l’une comme chez l’autre, la construction va avec la destruction, la structure avec son déséquilibre, la composition avec sa mise en crise. Elles ne parlent pas la même langue, mais elles partagent ces constats communs. Pour survivre, elles ne peuvent qu’en rire, d’un rire joyeux et joueur.